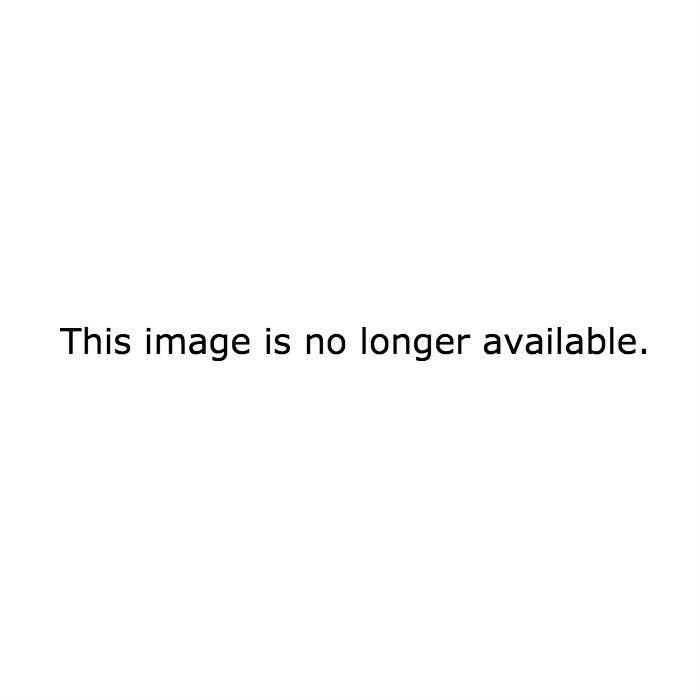
Parler de Suicide Squad, c'est parler de Harley Quinn.
Avec son accoutrement bariolé, la petite copine et complice maléfique du Joker a su conquérir son monde, libérée de sa mélasse psychotique pour quelques minutes sous les projecteurs dans la nouvelle franchise de DC Comics. À l'instar de ses acolytes du Suicide Squad, une bande de méchants œuvrant pour le bien, autant par coercition que par leur propre cupidité, Harley Quinn n'est qu'une starlette de comics –rien à voir avec Superman (même s'il est cité dans le film) ou Batman (qui, sous les traits de Ben Affleck, y fait une courte et ténébreuse apparition).
Harley est une psychiatre tombée amoureuse du Joker (Jared Leto) lors de son internement à l'asile d'Arkham. Dans un mélange d'amour fou et de syndrome de Stockholm, elle quittera tout pour lui. Jamais à court d'observations guillerettes, comme lorsqu'elle s'exclame «quelle aventure!» après avoir survécu à un crash d'hélicoptère, difficile d'ignorer qu'elle n'est pas très saine d'esprit. L'actrice qui l'interprète, Margot Robbie, n'est pas la plus célèbre de l'affiche de Suicide Squad –la palme revient évidemment à Will Smith/Deadshot– mais elle est incontestablement la star de sa campagne marketing. Peut-être parce qu'elle est reconnaissable entre mille avec son look de pom-pom girl déjantée. Ou peut-être parce qu'elle se trimbale toujours en slip.
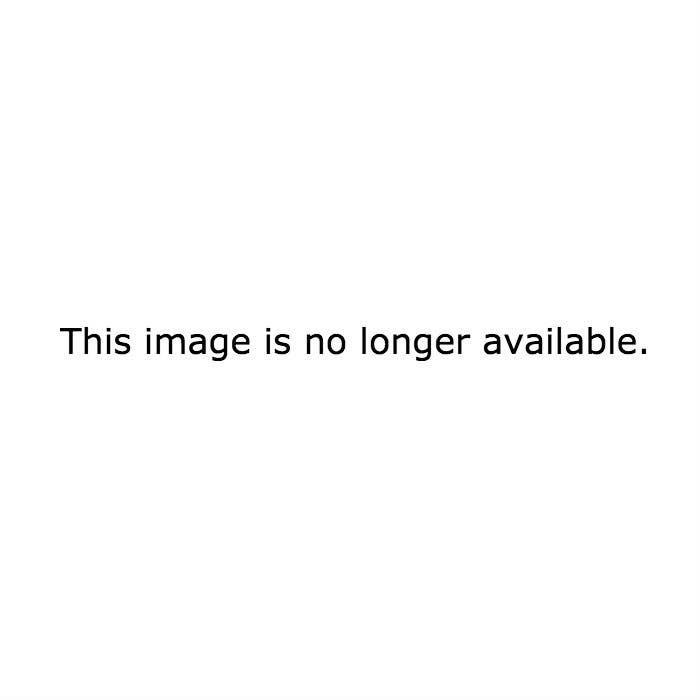
À elle seule, Harley Quinn incarne toutes les contradictions de ce désastre cinématographique qu'est Suicide Squad, écrit et réalisé à la va-comme-je-te-pousse par David Ayer. Elle est censée faire rire, parce qu'elle est trooop fofooolle, sauf qu'elle est aussi une femme embourbée dans une relation abusive, que le film ne sait absolument pas par quel bout prendre. Elle est censée être une femme à poigne et n'y va effectivement pas avec le dos de la cuillère avec sa batte de base-ball, sauf qu'elle est aussi prisonnière de l'emprise
psychologique du Joker, ayant abandonné toute son autonomie. C'est une icône gothique aux airs de Bonnie Parker, avec son revolver au barillet gravé «love» et «hate», sauf qu'au fond de son petit cœur, elle s'imagine en bigoudis, s'occupant de ses enfants et attendant la bouche en cœur que son mari aux cheveux verts rentre pour le dîner. Elle est chaotique, mais en fait non. Toujours joviale, mais en fait non. Cinglée, mais en fait non –ou, du moins le film ne se donne jamais vraiment les moyens de l'explorer. Évidemment, Harley est un personnage complexe, sauf que le film en fait une bimbo. Un film qui cherche à être cool et sombre à la fois, et qui aurait pu l'être s'il avait su voir plus loin que le popotin à paillettes de son actrice principale.
Suicide Squad est un film de scélérats et de criminels qui semble vouloir chambouler la
norme super-héroïque, mais qui demeure en réalité atrocement rétrograde dans ses choix. Ses personnages sont censés être des durs à cuire débordant d'égoïsme, des marginaux sans foi ni loi, mais qui se jurent fidélité éternelle plus vite qu'un groupe de
collégiens en fin de colonie de vacances. Son intrigue est exaspérante de circularité –le Suicide Squad est activé pour combattre un ennemi ridicule qui n'aurait pas vu le jour si quelqu'un n'avait pas eu l'idée de l'activer. Ce quelqu'un, c'est Viola Davis, qui incarne Amanda Waller, agent fédéral ambitieuse, dont le regard d'acier indique clairement qu'elle a déjà tout vu. (Sa meilleure scène, c'est quand elle
casse la croûte alors même qu'elle expose à quelqu'un d'autre le dossier d'un malfrat qu'elle espère mettre derrière les barreaux –preuve que ses exaspérants supérieurs ont de quoi trembler, elle serait capable de n'en faire qu'une bouchée). Mais même Davis
n'arrive pas à faire oublier que le film repose entièrement sur les idées débilissimes de Waller, qui auront comme conséquence principale de réduire en poussière une bonne partie de Midway City.
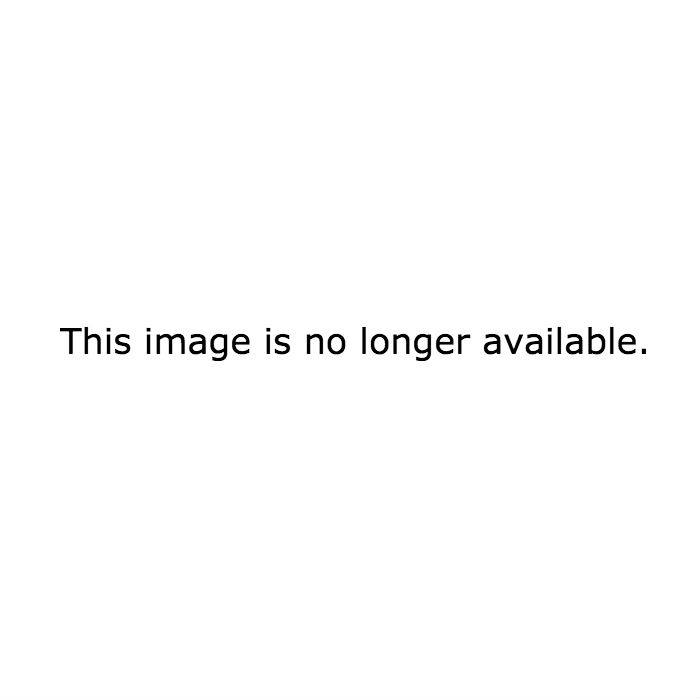
Reste que par rapport aux
autres personnages féminins de Suicide Squad, Waller réussit à sauver les meubles. Des femmes qui sont visiblement incapables de
se contrôler et qui ne sont là que pour attirer dans leur chute les hommes qui les entourent (pardon pour Jai Courtney/Captain Boomerang
et Adewale Akinnuoye-Agbaje/Killer Croc qui, si le scénario leur avait accordé un peu de jugeote, auraient dû quitter le navire au bout d'une demi-heure). On peut citer Cara Delevingne, incarnant
l'archéologue June Moone, parfaite dans son rôle de caniche humain, et l'Enchanteresse, la sorcière ancestrale qui la possède et qui use jusqu'à la corde les talents d'actrice encore en germe du mannequin. En matière de super-pouvoirs, l'Enchanteresse écrase tous les
autres personnages, sauf que June n'est qu'un vulgaire pion, autant abusée par l'esprit que par Waller, qui s'en sert pour s'assurer de la docilité de Rick Flag (Joel Kinnaman), l'amant de June.
On n'oublie pas Katana (Karen Fukuhara), inexplicable alliée de Flag, assoiffée de vengeance et experte en sabre japonais, qui laisse ce dernier s'exprimer pour elle une bonne partie du film, tant et si bien qu'on vient à se demander si elle est oui ou non dotée de parole. Il y a la femme et les enfants que l'incendiaire El Diablo (Jay Hernandez) regrette d'avoir tués. Et il y a la fille surdouée auprès de laquelle l'assassin Deadshot espère se racheter (le personnage interprété par Smith, tout en impertinence, tente d'avoir le style que le film aimerait avoir dans sa globalité, sans jamais y arriver).
Ayer est un réalisateur connu pour ses films crus et centrés sur des personnages masculins –et certains sont excellents, comme Fury, drame de guerre en mode écorché vif de 2014, ou End of Watch, policier largement filmé en caméra subjective sorti en 2012. Alors pourquoi lui avoir tendu les rênes d'un film au casting à moitié féminin, censé être plus léger et fun que la précédente franchise de DC, Batman v Superman: L'Aube de la justice? La première moitié du film est une quasi succession de clips musicaux, de Sympathy for the Devil à Seven Nation Army, en passant par Spirit in the Sky, dont les mélodies familières tentent de donner au film une légèreté qu'il n'a pas. Sauf qu'au bout d'un moment, Ayer se vautre dans une angoisse existentielle grossière (comme lorsque Deadshot fixe avec un air de chien battu un mannequin d'enfant dans une vitrine), histoire d'humaniser un casting surpeuplé –une angoisse reposant sur l'utilisation des femmes, accessoires de la souffrance masculine.
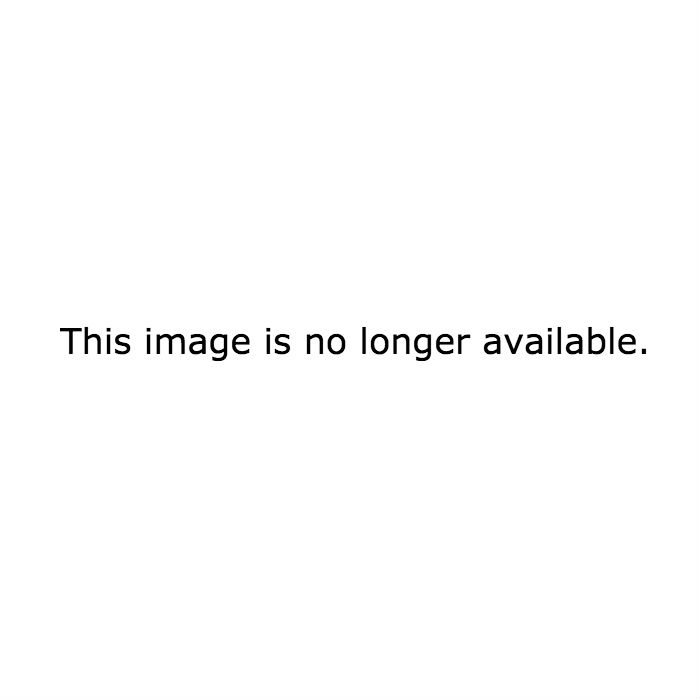
Ce qui nous ramène à Harley Quinn, dont la seule épaisseur narrative est réduite à ses souvenirs de vie commune et perturbée avec le Joker, tout en brûlant de le retrouver. La mise en scène de ce chaos relationnel est l'élément le plus audacieux du film. On la voit se transformer pour devenir la femme idéale, trophée de son compagnon maléfique. Elle renonce à sa santé mentale, à son existence, à ses goûts vestimentaires pour être avec lui. Elle met toute sa vie en danger pour prouver sa dévotion. C'est une version malsaine de l'amour fou –ou, du moins, de ce qu'il peut être dans l’œil embrouillé de Harley. Et, comme elle, le film est esclave du cabotinage exaspérant de Leto/Joker (dont le temps de présence à l'écran est inversement proportionnel dans le film à celui dont il jouit dans ses bandes-annonces). Le point de vue du film sur leur relation ne se démarque jamais de celui de Harley et de son amour vaseux.
«Je dors où je veux, quand je veux, avec qui je veux», crache-t-elle au menton d'un gardien au début du film. Une déclaration d'indépendance en totale contradiction avec la cage mentale dans laquelle elle est enfermée et dont elle lèche les barreaux en étant persuadée de tout contrôler. Elle dont tout le rôle ne sert qu'à mettre en valeur un méchant esquissé, prochaine vedette d'un futur film. Harley Quinn est censée être le macabre pilier de Suicide Squad. Elle n'en est que la poupée déglinguée, simple support masturbatoire.
Traduit de l'anglais par Peggy Sastre
