
Parce qu'elle voulait s'habiller «comme une petite fille», Paola a été rejetée par sa famille équatorienne alors qu’elle n’avait que 8 ans. Elle a survécu à la rue jusqu'à ses 15 ans, avant de commencer à se prostituer. Puis elle a rencontré un homme, qui l'a battue pendant des années, et elle est devenue séropositive après avoir été violée par six hommes à la sortie d’une discothèque, alors qu’elle venait à peine d’arriver en France. Pourtant, c'est la prison, où elle n’a passé que trois jours, qui reste «la pire expérience» de sa vie. Un séjour à la maison d'arrêt de Lille (Nord), où elle a été transférée en 2014, «encerclée par une dizaine de policiers». «Les autres détenus étaient dans la cour, ils criaient "on ne veut pas de femme ici !". Ils voulaient tous me frapper», se souvient-elle aujourd'hui.
Paola a été incarcérée dans un établissement pour hommes, comme la grande majorité des femmes transgenres avec un état civil masculin et n'ayant pas subi d'opération dite «de réassignation génitale». En France, comme dans de nombreux pays, c’est le sexe inscrit sur les papiers d’identité qui régit le placement en détention ; du moins officiellement. «Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts, précise l’article D248 du code de procédure pénale. Mais qu’en est-il des personnes trans ou de genre non-binaire* ? Qu’est-ce qu’un homme, qu’est-ce qu’une femme, aux yeux de l’administration pénitentiaire ? Celle-ci semble bien avoir du mal à s'emparer de la question, alors que les détenu.e.s transgenres — en grande majorité des femmes — sont «les plus en souffrance» en prison, d’après Adeline Hazan, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL).
L'actualité récente l'a ainsi démontré, avec les conditions de détention «préoccupantes» d'une femme transgenre américaine nommée Kara B., condamnée dans l'affaire de la voiture incendiée. L'histoire de Paola est loin d'être un cas isolé. Daiana, Chloë, Ariana et Beatriz, qui ont également accepté de témoigner, ont toutes été incarcérées dans des établissements pour hommes, en dépit d'une transition de genre parfois très avancée.

Des femmes dans des prisons pour hommes
Originaire d’Argentine, Daiana, le visage cerné par de grands anneaux rouges et les cheveux teints en blond, raconte avoir été incarcérée pendant un an à la maison d’arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis (Essonne) parce que son état civil était masculin. Elle était dans une cellule du bâtiment D3, où a été aménagé un quartier spécifique pour les détenus dits «vulnérables», parmi lesquels plusieurs femmes transgenres. Six, environ, y étaient enfermées à son arrivée, en décembre 2012.
«On m’a dit "non, tu n’es pas opérée"»
Beatriz y a également fait un passage en septembre 2013, pour deux ans. «J’ai fait une demande pour aller chez les femmes, on m’a dit "non, tu n’es pas opérée". Mais je suis une femme !», défend-t-elle en montrant son passeport argentin… qui lui octroie un état civil féminin. Dès lors, pourquoi la placer chez les hommes si l’on s’en tient au code de procédure pénale ?
«Chaque État est souverain dans les règles d’octroi de la nationalité, commente son avocat, Joachim Cellier. Ce n’est pas que la loi française ne reconnaît pas l’état civil argentin, mais elle dit : vous avez un état civil qui ne correspond pas à votre corps, donc à vous d’aller jusqu’au bout de votre démarche. Pour l’administration pénitentiaire, la seule chose qui compte est le sexe physique. S’il y a un pénis c’est un homme, s’il n’y en a pas c’est une femme, c’est bête et méchant.»
Cette règle tacite ne s’applique pourtant pas à tous. De nationalité équatorienne et avec un état civil masculin, Ariana a été opérée en août 1998, le jour de son anniversaire. Arrêtée à Nantes (Loire-Atlantique) en novembre 2011, elle a d’abord été placée à la maison d’arrêt pour hommes de Lorient, à 170 km de là, dans le Morbihan. «Je suis restée là-bas pendant une semaine, à attendre la réponse de Fleury-Mérogis, même si je ne voulais pas y aller. On m’a dit "c'est une prison moderne, adaptée à vous". J'ai pensé qu'elle était adaptée aux femmes.» Mais arrivée là-bas, c’est la douche froide : «J'ai lu "prison pour hommes". Tout le monde me dévisageait, se moquait, y compris les surveillants. L’un d’eux m’a regardée et m’a dit : "Il doit y avoir erreur, c’est une prison pour hommes ici." Je pleurais dans ma cellule, à l’isolement, je ne l'ai pas supporté», raconte-t-elle, les larmes aux yeux encore aujourd’hui.
Le 13 janvier 2012, Ariana est finalement transférée à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury. Mais le soulagement est de courte durée : trois mois plus tard, l’administration pénitentiaire ordonne son retour au bâtiment D3, chez les hommes.
«J’ai dit que j’allais porter plainte. Finalement, ils m’ont emmenée voir un gynécologue pour vérifier que j’étais vraiment une femme... C’était une comédie !, poursuit Ariana, à qui l’accès à une consultation gynécologique avait été refusé tout au long de sa détention en quartier hommes. Puis on m’a dit, "maintenant qu’on voit que vous êtes une femme, vous allez être transférée chez les femmes, à Fleury".»
Ce n’est qu’à la fin de sa détention provisoire qu’elle sera finalement affectée à la maison d’arrêt pour femmes de Nantes — sa première demande, pour se rapprocher de son lieu de résidence et de son compagnon de l'époque.
«Chaque prison fait sa propre cuisine»
Dans cette cacophonie, difficile de savoir finalement quelle règle prime pour les personnes trans, tantôt réduites à leurs organes génitaux, tantôt à leur état civil. Alors chacun se débrouille comme il peut, quitte à parfois contourner la loi.
«Globalement, des efforts sont tout de même faits, mais il y a perpétuellement un risque que ce soit remis en question, car chaque prison fait sa propre cuisine. Un changement de directeur peut complètement renverser une situation dans un établissement, en bien comme en mal», fait observer François Bès, coordinateur du pôle enquêtes à l'Observatoire international des prisons (OIP).
Michel Fix, qui a été médecin-chef de l’unité de consultations et soins ambulatoires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis durant 13 ans, admet avoir à plusieurs reprises préconisé une détention chez les femmes pour des personnes transgenres opérées, mais possédant encore un état civil masculin.
«J’ai aussi souhaité que soient placées en détention pour femmes des transgenres non opérées mais d’allure très féminine. Cependant, l’administration pénitentiaire a ensuite refusé ce genre de détention en fonction d’une note de rappel de Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, précisant que tout détenu à l’immatriculation sociale et au patronyme masculins ne pouvait pas être incarcéré avec les femmes, quelle que soit son évolution physique.»
Anne Lécu, médecin à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, se souvient d’un cas en particulier : «Pour une personne qui voulait un rapprochement familial, il est arrivé que l’on me demande "où on le met ?". J’ai répondu de façon claire que ce n’était pas à moi de décider. C’est un engrenage dans lequel je ne veux pas rentrer.» Sur une dizaine de suivis depuis 2000, elle affirme n'avoir eu «aucune expérience négative avec une personne transgenre opérée chez les femmes» : «Toutes celles qui souhaitaient des hormones en ont eu.»

«Ils m'ont dit que je n'avais qu'à la couper moi-même»
En détention hommes, le constat est beaucoup plus mitigé. L’accès aux traitements est loin d’être acquis, pour cette population qui cumule déjà souvent les soucis de santé. «Très clairement, les personnes transgenres ont plus souvent des hépatites et le VIH, elles sont nombreuses à avoir des vies difficiles, dans des situations très précaires», fait remarquer Anne Lécu.

«Quand elles sont incarcérées, elles se retrouvent sans traitement du jour au lendemain et le vivent très mal, et ce jusqu’à ce qu’elles me voient, maximum un mois après leur arrivée. Je donne toujours un traitement hormonal, mais si elles ont d’autres soucis, liés ou non à leur transsexualité, c’est compliqué», raconte pour sa part l'endocrinologue Alfred Penfornis, qui intervient une fois par mois à la maison d’arrêt des hommes de Fleury et une tous les deux mois chez les femmes.
Des détenues peuvent ainsi se retrouver sans leur traitement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. «Ils n’ont pas voulu me donner mes hormones, je n’en ai eu que deux mois avant que je sorte», raconte Beatriz. Même constat pour Ariana, qui en a beaucoup souffert : elle a dû attendre d’être transférée chez les femmes pour en bénéficier. Daiana confie quant à elle avoir été privée d’hormones en raison de son hépatite C. Alors qu’elle vivait déjà avec le VIH (dont la charge virale est indétectable depuis 2007), la détention l’a encore plus fragilisée : «Un cancer s’est développé en prison. J’étais nerveuse, déprimée. S’ils ne m’avaient pas libérée, je serais morte car ils ne faisaient rien pour moi.» En décembre 2013, elle est finalement transférée à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, où ils lui diagnostiquent la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique, et subit une opération.
Prise d'hormones en cachette
Libérée en avril 2014 après avoir été incarcérée pendant 16 années dans plusieurs établissements en France, Chloë a été l’une des premières à réclamer un traitement hormonal et des vêtements féminins en détention. Alors qu’elle portait des jupes en cachette le soir dans sa cellule, un surveillant lui a un jour demandé de se changer. De là est né son long «combat» pour devenir la femme qu’elle estimait avoir toujours été. Chloë a commencé par une grève de la faim, de trois mois. Et des automutilations, nombreuses. «J'ai brûlé mes bras, je me suis mutilée à coups de lames de rasoir, je me suis coupé un doigt», confiait-elle peu après sa sortie de prison, les bras couverts de nombreuses cicatrices. En 2005, Chloë demande à rencontrer un endocrinologue pour commencer un traitement hormonal. On lui promet un rendez-vous, qui ne vient pas. Quelques mois plus tard, un détenu revenant de permission lui apporte des hormones en cachette. Une pilule contraceptive qu'elle prendra quelques jours, en attendant le traitement officiel, qui lui est accordé en juin 2006 par le service médico-psychologique régional de Caen. Mais peu après, sa demande d'opération chirurgicale ne passe pas : «Quand j'ai réclamé une ablation de cette chose, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit, que je n'avais qu'à la couper moi-même.» Chloë prend cette provocation au pied de la lettre : en février 2006, elle est adressée aux urgences après s'être mutilée la verge avec un clou. Puis en 2008 et en 2009 pour «nécrose des testicules» et «surinfection». Ce n’est qu’en 2013 qu’elle obtiendra finalement l’opération désirée, après de nouvelles séries de violences insoutenables.
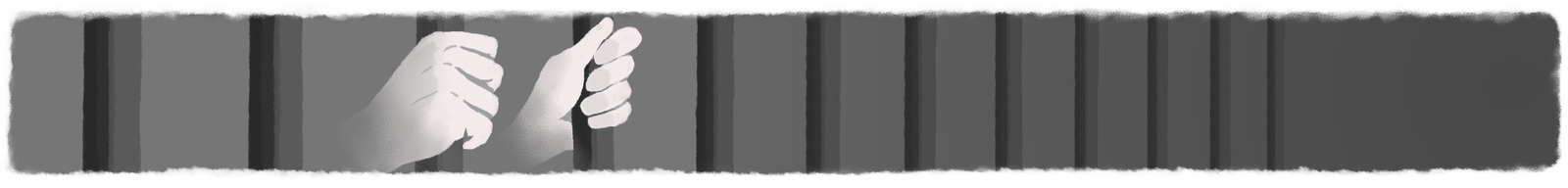
«On m'a d'abord dit oui, puis non»
En décembre 2012, une note de service autorise Chloë «à cantiner* produits et vêtements féminins, lesquels devront être utilisés et portés uniquement en cellule». Elle obtient son premier soutien-gorge, du maquillage, une machine à coudre pour lui permettre de concevoir ses propres jupes. «Oui, et avec un pompon rose», se moque toutefois un gardien lorsqu’elle demande une chemise de nuit. Pour cause : «Le maquillage et les vêtements féminins sont interdits en détention, mais il est possible de sortir en jupe en permission», assure un surveillant de Caen préférant rester anonyme. Le code de procédure pénale permet en réalité à chaque prison d'appliquer, là encore, ses propres règles. Il précise : «À titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.» Un ex-gradé à la maison d’arrêt pour hommes de Fleury, souhaitant lui aussi rester anonyme, assure ainsi que «le port de vêtements féminins est autorisé». «Ça été compliqué mais j’en ai eu, confirme Beatriz. On m’a d’abord dit non, puis oui.» Mais alors qu’elle était incarcérée dans le même quartier, Daiana n'a pas eu autant de chance : «Je ne pouvais rien avoir de féminin, ni soutien-gorge, ni maquillage.»
«Avec une meilleure réglementation, il y a des conflits que l’on pourrait éviter», met en avant le surveillant de Caen. Ce qui vaut pour les fouilles également. Car c’est en réalité dès leurs premiers pas en prison que les personnes trans sont victimes de la confusion la plus totale, et sans doute la plus flagrante, de l’administration pénitentiaire.
«Un homme pour fouiller le bas et une femme pour le haut»
A son arrivée à Fleury, Ariana a été fouillée par une femme, avant qu’un supérieur n'ordonne à cette dernière d’arrêter. «Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine», dispose l’article R57-7-81 du code de procédure pénale, difficilement applicable aux personnes trans. En 2010, la directrice du centre pénitentiaire de Caen, Karine Vernière, pense donc bien faire en ordonnant que la fouille à corps de Chloë soit réalisée par deux surveillants : «Un homme pour le bas et une femme pour le haut.» «Compte-tenu de sa poitrine, j'avais pensé à l'époque, mais sans doute un peu vite et un peu seule, que c'était une bonne solution», expliquait-elle fin 2014 — la direction de l’administration pénitentiaire ayant refusé une nouvelle demande d’interview. Mais le ministère de la Justice avait alors fait annuler sa note de service : une personne qui est administrativement un homme doit être fouillée par un homme.

Une transphobie exacerbée en prison
Du côté des surveillants, pas formés aux problématiques transidentitaires, ça dégénère. Entre les murs se cristallise alors la transphobie de la société, exacerbée par un système inadapté. En 2010, un tract d'un surveillant de la CGT pénitentiaire fait mention, en parlant de Chloë, d’un «détenu dont on ne sait pas s'il est mâle ou femelle et qui nous enquiquine (pour ne pas dire autre chose) et accessoirement, nous fait passer pour des cons en extraction…». Cette transphobie des gardiens, Beatriz ne s’en souvient que trop bien :
«Quand des trans qui ne parlaient pas français sont arrivées, ils en ont profité pour les traiter de "travelos". Même les filles surveillantes se moquaient : "Regardez, c’est un travesti !" C’est la première fois que ça m’arrivait. Dans mon pays, j’étais respectée.»
«Ils m’ont traitée de pédé, m’ont craché dessus»
Beatriz ne s'attendait pas non plus à une telle violence, psychologique comme physique, de la part de ses codétenus. «Pour m’amener au tribunal, on m'a mise dans une camionnette avec des garçons. Ils m’ont traitée de pédé, m’ont craché dessus, raconte-t-elle. Je l’ai dit au juge et on m’a répondu que c’était normal : "Parce que vous êtes une prostituée, vous êtes censée être habituée à tout ça."» Elle a été agressée une fois en détention, par un homme placé dans le même quartier :
«La nuit, on regardait la telenovela [un feuilleton hispanophone], puis on parlait à travers les fenêtres. Je crois que ça ne lui a pas plu. Le lendemain, il m’a frappée à la salle de sport. Il m’a jeté une bouteille d’eau sur la tête, les surveillants n’ont rien fait.»
A Lille, Paola a également été traumatisée : «Un prisonnier a voulu m’attaquer avec un couteau. Je suis restée enfermée à l’isolement pendant deux jours, c’était très difficile.»
Chloë, elle, rapporte avoir été violée trois fois au centre pénitentiaire de Caen. Dans sa cellule, aux douches et au self, alors qu'elle le nettoyait un dimanche matin. Elle n'en dira pas plus :
«J'ai préféré ne pas l'ébruiter et ne pas porter plainte, j'ai juste dit que j'avais eu des ennuis.»
S'il est impossible d'avoir des données précises à ce sujet en France, plusieurs enquêtes américaines ont mis en avant la prévalence des abus sexuels chez les détenu.e.s trans. Dans un rapport, le bureau des statistiques du ministère de la Justice américain affirmait qu'en 2011-2012, 33,2 % des personnes transgenres incarcérées dans les prisons fédérales et d'Etat avaient été agressées sexuellement par un autre détenu, contre 4 % pour l'ensemble de la population carcérale.
À cela s'ajoutent d'autres facteurs aggravants, comme à Caen, où la grande majorité des détenus sont incarcérés pour des affaires de mœurs. Les situations deviennent alors explosives. Suite au passage de Chloë dans cette prison, «la directrice a mis en place des réunions régulières pour les surveillants, sur la base du volontariat, pour mettre en avant les particularités de l'établissement», rapporte le gardien du centre pénitentiaire. «Ils y abordent aussi la spécificité des détenus transgenres», ajoute-t-il. Pour s'adresser aux personnes trans, lui s'en tient néanmoins au règlement et à l'état civil, comme bon nombre de ses collègues : «Ce sont des détenus hommes, assure-t-il. On ne peut pas dire "elles".»
Parce qu'elle souhaite justement éviter ce type de comportement, l'association Acceptess-T a proposé à l'Enap, l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, de sensibiliser les personnels aux spécificités de la transidentité à travers des modules de formation. «Mais envoyé il y a plus de deux ans, notre courrier est resté sans réponse, si ce n'est un accusé de réception», déplore Giovanna Rincon, présidente de l'association, qui rend régulièrement visite aux détenues trans de Fleury-Mérogis pour les accompagner dans leurs démarches. Interrogé par BuzzFeed News à ce sujet, Youssef Badr, porte-parole du
ministère de la Justice, affirme :
«Au centre pénitentiaire de Caen, les personnels pénitentiaires suivent l’intervention d’un psychologue sur la question de la dysphorie de genre, tous les deux à trois mois. Dans les établissements qui n’accueillent pas de détenus en dysphorie de genre, l’intervention d’un psychologue n’est pas obligatoire. Néanmoins, elle peut être demandée, c’est laissé à la libre appréciation du directeur.»
L'Enap a quant à elle répondu par l'intermédiaire de son service de communication : «Cette question ne fait pas l’objet d’une intervention ciblée.»
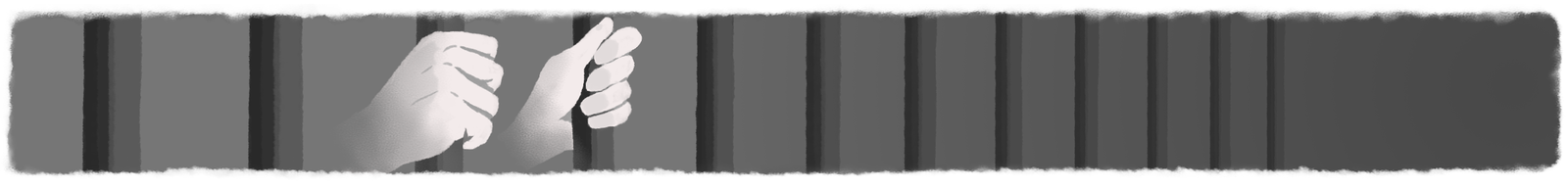
À l'isolement, «on est comme des chiens»
Au motif d'assurer leur sécurité dans un tel contexte, de nombreuses personnes transgenres sont placées à l'isolement ou dans des quartiers spécifiques. «Mais techniquement, les deux correspondent à la même chose», estime Amélie Morineau, qui a été responsable du Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées (Genepi) à Fleury pendant deux ans. Beatriz l'a constaté : «On ne pouvait rien faire, on avait seulement droit à une promenade deux fois par jour.» «Dans un tout petit endroit. On était comme des chiens», renchérit Daiana. La bénévole du Genepi décrit : «Dans le quartier spécifique, la cellule est individuelle, contrairement au reste de la prison, mais elles ne peuvent pas descendre en cour de promenade avec les autres.» Elles ont la leur :
«Une pièce de béton dont on a retiré le plafond, qui doit faire cinq mètres sur trois. Elles ne bénéficient pas non plus des activités proposées aux autres détenus car ils ne doivent pas être mélangés.»
Alors que son passage en établissement pour femmes s'était fait sans encombres – accès aux soins, au travail et aux activités, déplacements normaux, bonnes relations avec ses codétenues – Ariana souffrait d'un double isolement chez les hommes. Parce qu’elle a bénéficié d’une opération génitale, ses contacts humains se limitaient aux gardiens. «Quand j’allais en promenade, ils me mettaient loin de mes copines. Pourquoi ? "Parce que vous êtes une femme". Mais vous me dites depuis le début que je suis un homme, là vous me dites que je suis une femme, vous vous moquez de moi ou quoi ?», s'exaspère-t-elle en mimant la scène.
«Après Noël, j’ai voulu me suicider»
Comme d’autres, Ariana a envisagé le pire : «Après Noël, j’ai voulu me suicider. Une femme a ouvert la porte de ma cellule et m’a demandé ce que je souhaitais. Je lui ai répondu que je ne voulais pas vivre.» En octobre 2012, elle a intenté une action en responsabilité de l’administration pénitentiaire pour réclamer une indemnisation de ses conditions de détention.
«On a obtenu 2 000 euros, commente son avocate, Talia Coquis. C’était une décision courageuse, mais ils ne sont pas allés très loin. C’était une somme surtout symbolique. J’ose espérer que cette décision pourra faire jurisprudence pour d’autres.»
Le 14 novembre 2012, c’était Nathalie, placée à l’isolement à Caen, qui mettait fin à ses jours, après une succession de refus de l’administration pénitentiaire, de lui accorder un traitement hormonal notamment. Le jour-même, elle s’était vue notifier par son avocate le rejet de sa requête de changement de prénom à l’état civil. Nathalie s'est pendue avec le câble de sa télé dans la nuit qui a suivi.

Pas d'améliorations depuis l'avis du CGLPL
Au 1er novembre 2016, 13 personnes transgenres étaient détenues en France, selon le ministère de la Justice, qui estime que ce nombre varie de 15 à 30 suivant les années : «Elles étaient incarcérées dans huit établissements différents, la majorité se trouvant au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.» Et elles seraient entre 10 et 15 à alerter l’Observatoire international des prisons tous les ans, selon François Bès. Le 30 juin 2010, après avoir été saisi par Chloë, Jean-Marie Delarue, alors CGLPL, avait publié au journal officiel un «avis relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées». Il y dénonçait déjà «l'absence de principes directeurs» et émettait une série de recommandations, parmi lesquelles la modification du fameux article D248 du code de procédure pénale. La lettre que lui avait alors adressée la garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, fait écho à la réponse du porte-parole du ministère de la Justice aujourd'hui :
«Théoriquement et conformément à l’article D248 du code de procédure pénale, "les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts". A ce titre, l’administration pénitentiaire est tenue par l’identité inscrite dans les documents d’état civil présentés lors des formalités d’écrou. Cette identité peut toutefois ne pas correspondre à leur genre apparent. A ce titre, l’affectation des personnes transsexuelles s’effectue dans les faits au mieux des intérêts de la personne (encellulement individuel, affectation dans un secteur de détention favorisant la prise en charge des personnes vulnérables, placement à l’isolement) et des impératifs de gestion des établissements pénitentiaires», a répondu Youssef Badr à BuzzFeed News.
Alors que sept années se sont écoulées depuis, le constat reste donc sensiblement le même. «Ce que nous disions dans le rapport de 2010 est toujours malheureusement d'actualité», regrette Adeline Hazan, qui a pris la relève à la tête du CGLPL.
L’évolution récente des procédures de changement d’état civil, restée insuffisante pour certaines associations, change-t-elle la donne ? «On n'a pas suffisamment de recul sur l'application de cette loi. Et on a encore du mal à faire les démarches pour les personnes en liberté, alors on peut présumer que ça va être très compliqué pour celles qui sont incarcérées. C'est quand même une requête auprès du juge...», commente Giovanna Rincon, d'Acceptess-T, pour qui les personnes n'ayant pas acquis la nationalité française sont par ailleurs totalement laissées de côté.
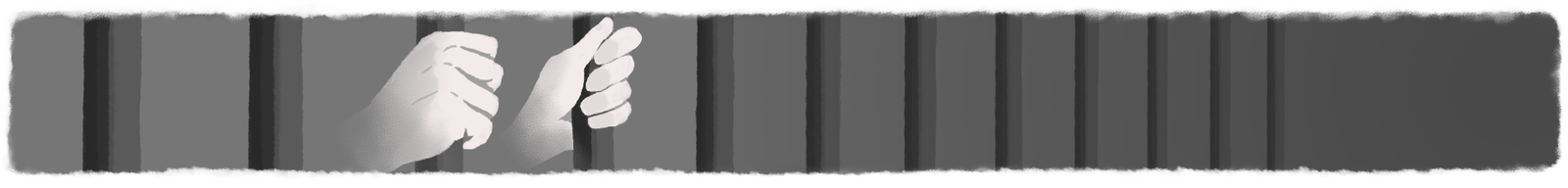
Aucune directive nationale
Erwann Binet et Pascale Crozon, ex-députés PS, ont découvert cette problématique au cours de leurs auditions pour l’amendement visant à faciliter le changement d’état civil des personnes trans.
«J’avais parlé de la situation des transsexuels en détention lors de la première réunion du groupe d’études sur les prisons, parce que je venais d’être confrontée à un témoignage d’une femme incarcérée chez les hommes qui m’avait beaucoup perturbée, confie l’ex-députée du Rhône. Suite à ça, on avait écrit à Jean-Jacques Urvoas et on l’avait rencontré pour lui expliquer qu’il y avait un vrai problème. Il a dit qu’il allait y réfléchir, mais c’était à la fin du mandat...»
Aux yeux d’Erwann Binet, nul besoin de loi pour améliorer le quotidien des personnes transgenres incarcérées, mais «simplement de directives claires et harmonisées de la garde des Sceaux». « Il faut qu’on se préoccupe de cette situation place Vendôme, or à ce jour personne ne l’a fait, regrette-t-il. Mais tout comme personne ne s’était occupé du changement d’état civil, qui était une première étape indispensable. Il y avait une vraie réticence de Matignon à l’époque, une volonté de ne pas trop bouger à ce sujet.» Le ministère de la Justice n'est pas du même avis : «Il est évident que nous ne pouvons pas faire une circulaire pour une dizaine de personnes», rétorque Youssef Badr.
«Il n’y a donc aucune directive nationale, seulement des réflexions et des modalités d’accompagnement, qui peuvent varier en fonction de l’établissement.»
«En créant des ghettos, on prive les gens de socialisation»
Les pressions viendront-elles de l’étranger, alors que la France continue à être régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention, mais également la manière dont elle traite les personnes transgenres ? En janvier 2016, un rapporteur spécial des Nations unies a présenté au Conseil des droits de l’homme un rapport sur «la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la manière dont ils touchent spécifiquement les femmes et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres». Et pendant ce temps-là, d’autres pays envisagent des évolutions, jugées plus ou moins bénéfiques. En 2010, l’Italie prévoyait d’ouvrir à Pozzale, en Toscane, une prison n’accueillant que des personnes trans, mais le projet n’a finalement pas abouti. Pour François Bès, de l’OIP, il était de toute façon «contre-productif, puisqu’encore discriminant» : «En créant des ghettos, on prive les gens de socialisation», met-il en avant.
«En Colombie, en Argentine ou en Équateur, on a par contre un cadre normatif assez avant-gardiste, fait remarquer Jean-Sébastien Blanc, conseiller en matière de détention à l’Association pour la prévention de la torture (APT), basée à Genève. Les règlements pénitentiaires préconisent que le placement se fasse sur la base du genre tel qu’il est perçu, et en consultation avec les personnes concernées. Mais il existe néanmoins un grand fossé entre ce cadre législatif progressiste et la réalité sur le terrain.»
Faudra-t-il, en France, une figure aussi médiatique que Chelsea Manning aux États-Unis pour que les pouvoirs publics évoluent sur la question ? En juin 2016, le gouvernement annonçait la mise en place d'un «plan de mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes LGBT», élaboré en collaboration avec la direction de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. «Nous sommes plus particulièrement mobilisés par l’axe 5 de la priorité numéro 2, "poursuivre l’amélioration du traitement des personnes LGBT privées de liberté"», assure Youssef Badr. Celui-ci comprend trois actions :
- Inscrire à l’ordre du jour des commissions de surveillance des prisons, une fois par an, la question des actes anti-LGBT ;
- Favoriser, lorsqu’il en va de l’intérêt et de la protection des personnes concernées, et en tenant compte du bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’encellulement individuel des personnes en danger en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, sur leur demande, en évitant dans la mesure du possible un isolement en quartier spécifique ;
- Autoriser l’inscription d’une ligne d’écoute aux victimes d’actes anti-LGBT à la liste des numéros accessibles par les personnes détenues aux points phone en détention (numéro anonyme et gratuit).
Sur le budget annuel de 1,5 million consacré au plan, impossible toutefois de savoir combien sont dédiés à ce fameux axe 5 : «Ces chiffres n'ont pas vocation à être communiqués», répond le porte-parole du ministère de la Justice. Difficile également de connaître le détail de ces mesures non-contraignantes et l'état de leur mise en œuvre. Un an et demi après l'annonce de ce plan conçu pour une durée de trois ans, «ces projets sont actuellement en cours d’étude à la direction de l’administration pénitentiaire».
*Une personne ni exclusivement femme, ni exclusivement homme.
*Le cantinage est le terme qui désigne les achats pouvant être effectués par les détenu.e.s en prison.

